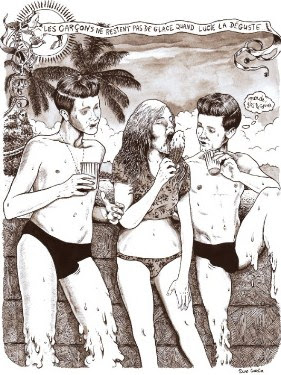Les
baby-sitters fans de Jonathan Richman en ont un jour rêvé, tout comme n’importe
quel parent branché : distraire leurs marmots avec un bon album d’indie-rock parfaitement
adapté, si possible composé par un végétarien californien obsédé par la bonne
bouffe. C’est ce qu’a réalisé l’enthousiaste Allen Bleyle, en l’espace de 12
chansons barrées et fruitées, avec son projet Apple Brains. Car si les comptines
s’adressent en premier lieu aux bambins (Bleyle fait d’ailleurs le tour des
écoles primaires et des camps de vacances avec sa guitare), nul doute que
n’importe quel indie-rocker de base trouvera son compte dans ces sucreries DIY parsemées
de bruits bizarres. En témoigne le pressage de l’album en cassette chez Burger Records et, plus récemment, en vinyle chez les garageux de Slovenly Records.
Si
Bleyle milite ardemment pour une nutrition saine et équilibrée on se demande
néanmoins si ces chansons n’ont pas été composées pendant une overdose de
sucre. Prenez par exemple "Peanut butter & jelly how they met song" ou encore
l’hystérique "Lots of different colors", qui auraient très bien pu résulter d’une
jam sous acide entre Bob l’Eponge et Dora l’exploratrice, le tout sous l’œil
pervers de Wayne Coyne des Flaming Lips. Heureusement derrière cet entassement
de bruitages rigolos (aboiements, splash, grognements, et j’en passe), de toy
instruments (vous trouverez des soli de kazoo) et de délires dadaïstes, se
cachent quand même des mélodies diablement efficaces qui empruntent aussi bien
à l’easy-listening qu’à l’indie-rock lo-fi des années 80, ou à l’anti-folk. Un
mélange assez psychédélique où l’on croirait entendre les Camper Van Beethoven
("Apple x3") ou l’ami Jeffrey Lewis ("Wonder Worm"). Et notre joyeux troubadour
pense aussi aux enfants plus calmes, en balançant quelques petites balades
toutes jolies, comme l’irrésistible ode à la mangue "A mango is a precious egg to be cherished".
Il
est difficile de résister à l’univers d’Allen Bleyle, qui a le mérite de
produire une musique inspirée et facile d’accès, sans prendre pour autant les
gosses pour des débiles (l’histoire d’un ver de terre super-hero c’est quand
même autre chose qu’une taupe chantante attardée). Un univers non-hermétique qui pourra
aussi faire swinguer vos vieux os.
Punching Joe
NB :
Ne vous étonnez pas trop quand même si, plus tard, votre enfant/petite
cousine/petit frère/or whatever, vous réclame du Zappa pour ses 10 ans.
Une interview pour en savoir plus le boy
Une interview pour en savoir plus le boy
"Apples x3"